

Racine de moins un
Une série d'émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle réalisée par Bertrand Louart.

Toutes les émissions de cette catégorie :

Racine de moins un
(RMU n°99 - 3/3 - 59 mn) Le 15 juin 2021, la répression « antiterroriste » (SDAT, GIGN et autre PSIG) s’abattait sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir provoqué des incendies pour dénoncer le déploiement du compteur Linky puis de la 5G. Il est frappant de constater que les moyens policiers employés pour mener l’enquête qui a conduit aux arrestations reposent sur les mêmes dispositifs techniques que ceux qui étaient dénoncés par les sabotages : traçabilité des citoyens par l’utilisation du réseau mobile et de la surveillance de l’espace public, élaboration et mise en correspondance de fichiers de renseignements, dépense d’énergie faramineuse, etc.
Entretiens avec différents intervenants présents aux rencontres organisées par le Comité 15 juin, en Limousin du 27 au 29 juin 2025 sur le thème « S’organiser contre l’informatisation de la société ».
Entretiens réalisés par Hervé le Berger.
Intervenants de l’épisode n°1 :
Julien, membre de l’association StopMines 23 (Creuse).
Miriam, membre de l’association StopMines 87-24.
Victor, membre de l’association StopMicro de Grenoble.
Dossier : Arrestations du 15 juin 2021 en Limousin et Procès de Limoges : un appel pour le droit du vivant.
Lien alternatif : Un 15 juin en Limousin.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°99 - 2/3 - 59 mn) Le 15 juin 2021, la répression « antiterroriste » (SDAT, GIGN et autre PSIG) s’abattait sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir provoqué des incendies pour dénoncer le déploiement du compteur Linky puis de la 5G. Il est frappant de constater que les moyens policiers employés pour mener l’enquête qui a conduit aux arrestations reposent sur les mêmes dispositifs techniques que ceux qui étaient dénoncés par les sabotages : traçabilité des citoyens par l’utilisation du réseau mobile et de la surveillance de l’espace public, élaboration et mise en correspondance de fichiers de renseignements, dépense d’énergie faramineuse, etc.
Entretiens avec différents intervenants présents aux rencontres organisées par le Comité 15 juin, en Limousin du 27 au 29 juin 2025 sur le thème « S’organiser contre l’informatisation de la société ».
Entretiens réalisés par Hervé le Berger.
Intervenants de l’épisode n°2 :
Sandrine L., membre de la coordination Stop 5G (Lyon) & du collectif Écran Total.
Nicolas Bérard, journaliste au mensuel L’Age de faire.
Matthieu Amiech, éditions La Lenteur & Écran Total.
Dossier : Arrestations du 15 juin 2021 en Limousin et Procès de Limoges : un appel pour le droit du vivant.
Lien alternatif : Un 15 juin en Limousin.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°99 - 1/3 - 60 mn) Le 15 juin 2021, la répression « antiterroriste » (SDAT, GIGN et autre PSIG) s’abattait sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir provoqué des incendies pour dénoncer le déploiement du compteur Linky puis de la 5G. Il est frappant de constater que les moyens policiers employés pour mener l’enquête qui a conduit aux arrestations reposent sur les mêmes dispositifs techniques que ceux qui étaient dénoncés par les sabotages : traçabilité des citoyens par l’utilisation du réseau mobile et de la surveillance de l’espace public, élaboration et mise en correspondance de fichiers de renseignements, dépense d’énergie faramineuse, etc.
Entretiens avec différents intervenants présents aux rencontres organisées par le Comité 15 juin, en Limousin du 27 au 29 juin 2025 sur le thème « S’organiser contre l’informatisation de la société ».
Entretiens réalisés par Hervé le Berger.
Intervenants de l’épisode n°1 :
Antoine, un des organisateur de la rencontre et membre du Comité 15 Juin (2021).
Camille, inculpée dans l’affaire du 8 Décembre (2020).
Serge Q., visiteur.
Henri Braun, avocat d’une des personnes poursuivie dans l’affaire du 15 juin 2021.
Dossier : Arrestations du 15 juin 2021 en Limousin et Procès de Limoges : un appel pour le droit du vivant.
Lien alternatif : Un 15 juin en Limousin.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°98 - 41 mn) Quentin Leicht, qui anime la chaîne Youtube intitulée Le Journal de l’Espace, nous parle des « méga-constellations, une bombe à retardement ».
La raison pour laquelle on envoie de plus en plus de fusées en orbite basse (entre 100 et 2000 km d’altitude) depuis moins d’une décennie, c’est pour assurer une couverture Internet mondiale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méga-constellations Starlink de SpaceX, mais il y a aussi d’autres projets comme Kuiper de l’américain Amazon, OneWeb du français Eutelsat, les chinoises Guowang et Qianfan ou l’européenne IRIS². C’est une accélération délirante de l’activité spatiale qui a déjà des conséquences délétères sur la couche d’ozone et la haute atmosphère.
Première émission de la série « escapade spatiale ».
Présentation détaillée : Méga-constellations - Méga-pollutions.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°97 - 60 mn) S’adapter, innover, télé-enseigner : Marion Honnoré, professeure de
philosophie, nous raconte la « continuité pédagogique » en temps de Covid,
quand la pandémie accélère la volonté de l’Éducation nationale de
dématérialiser l’école.
« Les cours en visio me donnent envie de mourir, seulement personne ne
veut me croire. Mon exagération supposée est perçue comme le signe de ma
bonne santé mentale. On te connaît, Marion. C'est bien toi. Tu en fais
toujours des caisses. Tu en rajoutes. [...] Allez, ça va passer, arrête un
peu ton char, c'est bon, c'est pas la mer à boire de faire des cours en
visio, y a des pays qui sont en guerre. »
Une lecture d'extraits de son livre publié aux éditions Le Monde à l'envers.
Présentation détaillée : Les cours en visio me donnent envie de mourir.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°96) Silvia Pérez-Vitoria, enseignante en agroécologie à l’Université internationale d’Andalousie (Espagne), travaille depuis de longues années sur les questions paysannes.
Dans le cadre de la tournée nationale de conférences-débats organisée par l’Atelier paysan sur le thème « La technologie va-t-elle sauver l’agriculture ? La place de la machine dans l’autonomie paysanne » à l’automne 2019, elle répondra aux questions : Comment les paysans ont failli disparaître ? Comment y a t il eu une ré-émergence des luttes paysannes dans le monde ? Son idée pivot : il faut redonner la centralité à la question paysanne.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°95 - 40 mn) Matthieu Amiech, des éditions La Lenteur et du groupe Écran Total, nous présente l’application pour Smartphone Fairtiq mise en place par la région Occitanie et les raison pour s’y opposer. Cette application propose des réductions de prix pour les trajets en train TER, à condition de disposer d’un Smartphone, d’accepter d’être géolocalisé et d’être débité sur son compte automatiquement.
Suivi d’une présentation du groupe “Écran Total, résister à la gestion et à l’informatisation de nos vies” et de ses récentes publications.
Lien alternatif : Fairtiq en Occitanie.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°94 - 60 mn) La Quadrature du Net a réalisé une série de quatre vidéos intitulées « C’est pas de l’Intelligence Artificielle » qui présente le résultat de ses enquêtes sur les conséquences de la numérisation des administrations sociales, de la surveillance policière et des infrastructures du numérique à Marseille. Derrière les discours fantasmés sur l'intelligence artificielle se trouve une réalité matérielle aux lourdes conséquences écologiques, sociales et politiques.
La Quadrature du Net promeut et défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique. L’association lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s’influencent mutuellement.
Lien alternatif: La Quadrature de l'IA.
Aucune diffusion


Racine de moins un
(RMU n°93 - 49 mn) Celia Izoard, journaliste et philosophe, spécialiste des nouvelles technologies au travers de leurs impacts sociaux et écologiques présente sur dernier ouvrage La Ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition (Seuil, janvier 2024).
Une nouvelle ruée minière d'une ampleur inédite a commencé. Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait produire en vingt ans autant de métaux qu’on en a extraits au cours de toute l’histoire de l’humanité.
Lien alternatif: Intoxication minière au XXIe siècle
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°92 - 61 mn) François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne, revient sur les Smart Cities : leur histoire, leur Big Data et leur évolution vers Big Brother. Tout cela au regard du projet local On Dijon !
Alors que la croissance urbaine s’accélère, les smart cities ne cessent d’être présentées comme l’outil majeur de la transition énergétique et socio-écologique. Pour nombre d’industriels et de politiques en effet, la smart city est l’infrastructure indispensable de la politique de transition qui doit remodeler les manières de produire et de consommer l’énergie et d’organiser la ville par une gestion optimale des flux.
Lien alternatif: Regard critique sur la Smart city.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°91 - 47 mn) Jean-Marie Brohm est professeur de sociologie à l’Université Montpellier III. Il est l’initiateur depuis les années 1960 de la « Théorie critique du sport » en France. Une critique sans concession qu’il va déployer dans de nombreux ouvrages et des revues : Partisans, Le Chrono enrayé ou Quel Sport ? Il revient sur quelques points essentiels de sa critique à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Invitation à redécouvrir ce pan aussi fécond que marginalisé de la réflexion sur le sport.
Lien alternatif: Critique de l’idéologie et de la pratique sportive.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°90 - 2e partie - 46 mn) Enseignant en philosophie, Anatole Lucet nous présente la vie et les idées du révolutionnaire socialiste et anarchiste Gustav Landauer (1870-1919), considéré en son temps par la police de l’Empire allemand comme « l’agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical ».
Très critique vis-à-vis des marxistes et du Parti social-démocrate allemand, alors le plus grand parti ouvrier d’Europe, Landauer pense que l’avènement de la société socialiste ne viendra pas de l’effondrement du système capitaliste « sous l’effet de ses propres contradictions ». L’idéal social doit au contraire être réalisé ici et maintenant dans des coopératives et des communautés, par des individus qui s’efforcent de s’extraire des habitudes induites par la colonisation de la vie quotidienne par la marchandise et l’argent. Pour lui, la révolution n’est pas dans la prise du pouvoir de l’État, mais bien dans cette préparation / élaboration d’une société libre.
Bibliographie complète et lien alternatif: Communauté et révolution chez Gustav Landauer.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°90 - 1er partie - 58 mn) Enseignant en philosophie, Anatole Lucet nous présente la vie et les idées du révolutionnaire socialiste et anarchiste Gustav Landauer (1870-1919), considéré en son temps par la police de l’Empire allemand comme « l’agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical ».
Très critique vis-à-vis des marxistes et du Parti social-démocrate allemand, alors le plus grand parti ouvrier d’Europe, Landauer pense que l’avènement de la société socialiste ne viendra pas de l’effondrement du système capitaliste « sous l’effet de ses propres contradictions ». L’idéal social doit au contraire être réalisé ici et maintenant dans des coopératives et des communautés, par des individus qui s’efforcent de s’extraire des habitudes induites par la colonisation de la vie quotidienne par la marchandise et l’argent. Pour lui, la révolution n’est pas dans la prise du pouvoir de l’État, mais bien dans cette préparation / élaboration d’une société libre.
Bibliographie complète et lien alternatif: Communauté et révolution chez Gustav Landauer.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°89 - 67 mn) Quel est le rôle de la propriété et des communs dans le cadre d’une gestion plus démocratique et plus sobre des ressources. Quel rôle pourrait jouer les communs dans une transition socio-écologique ? Doit-on abolir la propriété ?
Pour y répondre nous recevons Fabien Locher, historien de l’environnement, chercheur au CNRS qui a dirigé les ouvrages Posséder la nature (2018) et La Nature en commun (2020).
Lien alternatif: La propriété privée et les communs.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°88 - 58 mn) Buffon, Christophe Colomb ou Chateaubriand : depuis des siècles, les grands esprits du monde discutent des impacts de l’Homme sur son climat. D’où cette question, quelle est la place des débats climatiques dans l’histoire ?
Pour y répondre nous recevons Fabien Locher, historien de l’environnement, chercheur au CNRS. Il est co-auteur avec Jean-Baptiste Fressoz de l’ouvrage Les Révoltes du ciel, Une histoire du changement climatique XVe-XXe siècle, publié au Seuil en octobre 2020.
Lien alternatif: Le climat dans l'histoire.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°87 - 62 mn) Fondé sur une analyse radicale de l’exploitation systémique des femmes, des peuples colonisés et de la nature, l’écoféminisme consiste à faire de la politique autrement, en repartant de la vie quotidienne: lutter contre les oppressions par l’élaboration d’autres modes de vie, plus justes et écologiques, ainsi que par des mobilisations collectives et le recours à l’action directe. Resituant les inégalités – sociales, politiques, économiques – au cœur des réflexions écologiques, les analyses écoféministes sont parmi les plus complexes et englobantes – plus en réalité que celles de l’écologie, même politique, qui néglige trop certaines dimensions de la crise environnementale et tend de ce fait à préconiser des solutions (autoritaires, technologiques, industrielles) qui risquent d’aggraver les impasses actuelles.
Une tendance singulière et importante de l’écoféminisme est la perspective de la subsistance. Travail de (re-)production de la vie, domaine des tâches quotidiennes, invisibles, réalisés majoritairement par des femmes, la subsistance a pourtant été ignorée voire méprisée dans le féminisme comme dans l’écologie, et n’a que momentanément été remise au centre de l’attention par la crise sanitaire. La catastrophe écologique exige pourtant de repenser complètement nos manières de vivre et de travailler. Alors que notre dépendance au travail d’autrui et au système industriel s’accompagne d’une augmentation massive des inégalités et des atteintes au vivant, et alors que se multiplient les « solutions » basées sur un contrôle accru des humains et de la nature par la technologie ou par la gouvernance, la perspective de la subsistance pose un regard profondément critique sur cet état du monde.
Les deux intervenantes invitées pour cette séance, Veronika Bennholdt-Thomsen et Geneviève Pruvost, sont toutes deux sociologues. Les deux autrices partagent un point de départ très concret – la subsistance : cultiver, manger, se loger, prendre soin des personnes et de l’environnement, entretenir des relations sociales épanouissantes, etc. – ainsi qu’une proposition : repolitiser la production et l’entretien de la vie en articulant écologie, travail et rapports de pouvoir.
Les deux interventions de cette conférence développent cette perspective :
La Politique de la Subsistance, par Veronika Bennholdt-Thomsen, anthropologue sociale, , activiste, co-autrice avec Maria Mies de La Subsistance : une perspective écoféministe (traduit en français et publié par les éditions La Lenteur).
Quotidien politique : Écologie/féminisme par Geneviève Pruvost, sociologue, autrice de Quotidien politique : Féminisme, écologie, subsistance (2022, La Découverte) et de la préface à la réédition de Ecologie/féminisme. Révolution ou mutation ? de Françoise d’Eaubonne (à paraître, éditions du Passager clandestin)
Lien alternatif: La subsistance, une perspective écoféministe.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°86 - 62 mn) Patrick Marcolini, maître de conférence à l'Université de Montpellier, est l’auteur de l’ouvrage Le Mouvement situationniste, une histoire intellectuelle (L’Échappée, 2013).
Pour comprendre le concept de spectacle tel qu’il a été théorisé par l’Internationale situationniste – groupe révolutionnaire actif entre 1957 et 1972 – il est utile de revenir à ses origines, au contexte dans lequel il est apparu. Si dans au théâtre, le spectacle est un rapport de contemplation d’une activité qui se déroule indépendamment du spectateur, il va être analysé par les situationnistes comme le fondement des rapports sociaux dans la société contemporaine : les gens ne vivent pas, ils se contentent de regarder leur propre vie telle qu’elle leur est donnée à contempler. Patrick Marcolini expose de manière synthétique les différentes implications de ce concept développé par son principal théoricien Guy Debord dans son ouvrage La Société du spectacle (1967) pour la critique de la société contemporaine.
Lien alternatif: Le concept de spectacle.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°85 - 62 mn) François Jarrige, historien à l’Université de Bourgogne fait un expose de ses recherches sur la thème « Les animaux sont-ils des travailleurs comme les autres ? ».
Si depuis les débuts de leur domestication les animaux n’ont cessé de travailler au service des humains, les formes et l’ampleur de ce travail ont beaucoup varié selon les époques. En Europe, le nombre de chevaux, de chiens, de bœufs, de mulets utilisés pour tirer et soulever des charges, ou pour transformer des matières, s’est beaucoup accru aux XVIIIe et XIXe siècle avant de décliner sous l’effet de la motorisation et de l’électrification au siècle suivant. Massivement utilisés pour accélérer les transports, ils furent aussi une source majeure de force motrice, souple et flexible, adaptée à de nombreux contextes et situations de travail : dans les mines et les premières usines textiles, dans les plantations coloniales comme dans de nombreux ateliers artisanaux, ils furent attachés à des manèges pour produire de la force, broyer des matières.
Loin de les faire disparaître, l’industrialisation européenne a intensifié leur mise au travail, démultiplié leur présence dans les ateliers, à côté des enfants, des femmes et des ouvriers. Ces « moteurs animés » constituent un chaînon manquant et oublié de l’industrialisation et des transformations sociales du XIXe siècle. Le travail des bêtes s’est transformé parallèlement à celui des hommes, dans une logique de coopération et de rivalité, avant de devenir une source de rejets, de débats, voire de scandales.
Bibliographie
Ann Norton Greene, Horses at Work. Harnessing power in industrial america, Havard University Press, 2008.
Eric Baratay, Bêtes de somme, des animaux au service des hommes, Seuil (livre de poche), 2011.
Daniel Roche, La Culture équestre de l'Occident XVIe-XIXe siècle, tome I, “Le cheval moteur”, Fayard, 2008.
A paraître:
François Jarrige, La Ronde des bêtes - Le moteur animal et la fabrique de la modernité, La Découverte, septembre 2023.
Lien alternatif: Le travail des animaux à l’ère industrielle.
Aucune diffusion

Racine de moins un
(RMU n°84 - 63 mn) Mathieu Amiech, membre des éditions La Lenteur et du collectif Écran Total (résister à la gestion et l’informatisation de nos vies), revient sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 due a la diffusion du virus SARS-Cov-2 durant les années 2020-2022.
« Le point essentiel que je voulais souligner, c’est que considérer le Covid-19 comme un danger absolu, radicalement nouveau, qui change totalement notre situation personnelle et collective, cela n’est possible que si l’on refoule profondément le caractère pathogène de notre société capitaliste et industrielle. C’est-à-dire que l’on occulte le fait que l’on est déjà, en temps ordinaire, dans une situation où l’on est environné de dangers, de nuisances, qui viennent de beaucoup de nos habitudes de consommation quotidiennes déjà très ancrées. »
Lien alternatif: La gestion sanitaire de la covid-19.
Aucune diffusion
 Écouter
Écouter
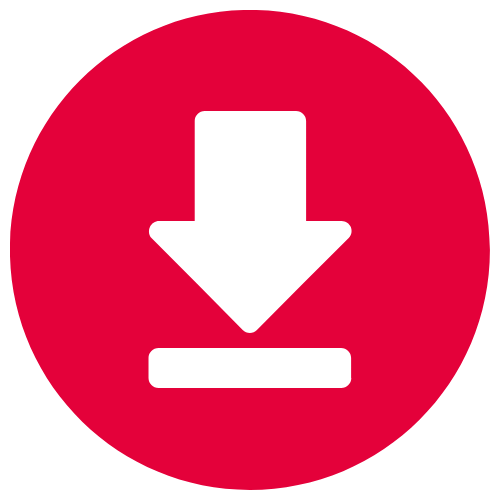 Télécharger
Télécharger